Actualité
Corinne Deloy,
Fondation Robert Schuman
-

Versions disponibles :
FR
EN
Corinne Deloy
Fondation Robert Schuman
Pour la neuvième fois depuis la transition démocratique, les électeurs espagnols sont appelés aux urnes le 14 mars prochain pour renouveler les deux Chambres de leur Parlement. José Maria Aznar, Premier ministre depuis mars 1996, a annoncé qu'il ne serait pas candidat et a choisi, après huit ans passés à la tête de l'Etat de se mettre en retrait de la vie politique nationale. Dans quelques semaines, une nouvelle personnalité sera chargée de représenter l'Espagne, celle-ci aura les traits soit de Mariano Rajoy, leader du Parti populaire et successeur de José Maria Aznar, soit de José Luis Rodriguez Zapatero, secrétaire général du Parti socialiste (PSOE).
Le système politique espagnol
Le Parlement (Cortes generales) comprend deux Chambres : le Sénat et le Congrès des députés. Celui-ci compte de trois cents à quatre cents députés, élus au moins tous les quatre ans au scrutin proportionnel plurinominal (sauf à Ceuta et Melilla) au sein des provinces espagnoles, circonscriptions électorales à peu près équivalentes aux départements français. Chacune des cinquante provinces que compte le pays possède au moins deux députés (un seul pour Ceuta et Melilla), le reste étant réparti entre les provinces en fonction de leur population. Le nombre moyen de sièges par circonscription est de 6,7. Notons qu'une liste doit obtenir au minimum 3% des suffrages pour être représentée au Congrès des députés.
Douze formations politiques sont représentées dans l'actuel Congrès des députés :
- Le Parti populaire (PP), formation conservatrice du Premier ministre José Maria Aznar, fondée en 1977 et au pouvoir depuis 1996 ;
- Le Parti socialiste ouvrier (PSOE), principal parti d'opposition fondé en 1879 et qui a gouverné l'Espagne de 1982 à 1996. Il est dirigé par José Luis Rodriguez Zapatero ;
- Izquierda unida (IU), alliance électorale de gauche née en 1986 ;
- Convergencia i union de Catalunya (CiU), alliance électorale catalane fondée en 1978, longtemps dirigée par Jordi Pujol et désormais emmenée par Artur Mas;
- Le Parti nationaliste basque (PNV), formation nationaliste et démocrate chrétienne, fondée en 1984 ;
- Le Bloc nationaliste galicien (BNG), parti nationaliste fondé en 1982 et dirigé par José Manuel Beiras ;
- La Coalition des Canaries (CC), formation régionaliste, alliée du Parti populaire au Parlement ;
- Le Parti andalou (PA), parti dont l'autonomie de l'Andalousie constitue la revendication principale ;
- Esquerra republicana de Catalunya (ERC), formation catalane de gauche créée en 1931 qui a dominé la scène politique catalane jusqu'au début de la guerre civile espagnole. Le parti est dirigé par Josep Lluis Carod-Rovira ;
- Iniciativa per Catalunya-Els Verds (IC-V), alliance de partis régionaliste et écologiste catalans ;
- Eusko Alkartasuna (EA), formation nationaliste et social-démocrate issue d'une scission du Parti nationaliste basque et fondée en 1986 ;
- Chunta aragonesista (CHA), parti nationaliste régionaliste pour une plus grande autonomie de l'Aragon.
Le Sénat compte deux cent huit membres élus au suffrage universel (sénateurs provinciaux) et quarante-neuf représentants désignés par les dix-sept communautés autonomes (sénateurs communautaires). Chaque province élit, quel que soit son nombre d'habitants, quatre sénateurs provinciaux, à l'exception de Ceuta et Melilla qui en élisent deux et des îles Baléares et des Canaries qui en élisent trois pour chacune des grandes îles (Grande Canarie, Majorque et Tenerife) et un pour les plus petites (Ibiza-Formentera, Minorque, Fuerteventura, Gomero, Hierro, Lanzarote et Palma). Chaque communauté autonome élit un sénateur communautaire plus un sénateur supplémentaire pour chaque million d'habitants.
Les élections sénatoriales ont lieu le même jour que celles pour le Congrès des députés. Le scrutin est également plurinominal, à l'exception de certaines îles.
La situation politique actuelle
Fidèle à sa promesse faite en 1996, après deux mandats à la tête du gouvernement, José Maria Aznar ne sera pas candidat aux prochaines élections législatives. « J'ai l'honneur et l'orgueil d'avoir servi l'Espagne. Je m'en vais avec la conscience tranquille et sereinement orgueilleux et satisfait. Je crois honnêtement que l'Espagne d'aujourd'hui, en 2004, est meilleure qu'en 1996 » a déclaré le Premier ministre. Il sera remplacé comme chef de file du Parti populaire par son ancien vice-président Mariano Rajoy. Ce Galicien de 48 ans a occupé durant les huit années de gouvernement Aznar de nombreux postes ministériels (ministre de la Fonction publique, de l'Education et de la Culture, de l'Intérieur) et est devenu en 2000 vice-président puis en juillet 2002 porte-parole du gouvernement. Le leader du Parti populaire affrontera le dirigeant du Parti socialiste, José Luis Rodriguez Zapatero, 43 ans, nommé juste après les dernières élections du 26 mars 2000.
Le Parti socialiste a récemment conclu un accord électoral avec les Verts. Cet accord prévoit que quatre membres de la formation écologiste seront inscrits sur les listes socialistes lors du scrutin du 14 mars prochain. Deux représentants des Verts seront placés en huitième position sur la liste électorale aux élections législatives dans les provinces de Séville et Valence et deux autres en troisième position aux sénatoriales partielles de la région de Madrid et de la province de Teruel. Un représentant écologiste sera également parmi les vingt premiers candidats de la liste du PSOE pour les élections européennes de juin prochain. Les écologistes, dirigés par José Maria Mendiluce, ne possèdent à ce jour aucun représentant au Congrès des députés ou au Sénat. Concernant une éventuelle coalition entre les socialistes, les communistes et les nationalistes catalans, l'incertitude demeure entière.
A la tête du pays depuis le 5 mars 1996, le Parti populaire ne semble pas connaître de réelle usure du pouvoir. Ces deux dernières années, la formation conservatrice a néanmoins affronté quelques crises politiques. La grève générale du 20 juin 2002 contre la réforme des prestations chômage a conduit le gouvernement à faire machine arrière à l'automne suivant et à annuler la quasi totalité du decretazo, décret qui avait été à l'origine de la mobilisation populaire la plus importante depuis la transition économique. Le 19 novembre de la même année, le naufrage du Prestige sur les côtes de Galice a provoqué une importante marée noire. José Maria Aznar et son gouvernement se sont vus reprocher leur gestion de cette crise écologique et économique. Si, six mois plus tard, les socialistes ont remporté lors des élections municipales qui se sont tenues le 25 mai 2003 la majorité des grandes villes de Galice (La Corogne, Vigo, Lugo et Saint-Jacques-de-Compostelle), le Parti populaire a conservé Orense, reprend Ferrol et est resté majoritaire à Muxia, trois villes situées sur la côte où s'est échoué le navire.
L'année passée, le Premier ministre a soutenu l'intervention anglo-américaine en Irak, n'hésitant pas à aller contre l'opinion de la grande majorité de ses concitoyens (90% des Espagnols s'y sont, à plusieurs reprises, déclarés opposés) qui ont été les plus nombreux en Europe à se mobiliser contre la guerre. La population n'a cependant pas tenu rigueur de sa position à José Maria Aznar et à son gouvernement puisque le Parti populaire, tout en perdant 6% de ses électeurs depuis le dernier scrutin local de 1999, a cependant remporté les élections municipales du 25 mai 2003, obtenant un plus grand nombre de conseillers municipaux et plus de suffrages dans les grandes villes que le Parti socialiste. Le Parti populaire est également sorti victorieux dans neuf des treize communautés autonomes dans lesquelles se tenaient ce même jour des élections régionales.
De leur côté, les socialistes ne sont pas sans connaître également des difficultés internes. En moins d'un an, ils ont ainsi traversé deux crises politiques. Alors que le 25 mai 2003, le PSOE, uni à Izquierda unida (IU), avait remporté d'une courte tête la région de Madrid (56 sièges, pour 55 au Parti populaire), la défection de deux élus socialistes lors de la première réunion de la nouvelle Assemblée régionale avait permis au Parti populaire (PP) de s'emparer de la présidence de la région. A la suite du blocage des institutions consécutif à ce vote, le Parlement de la région a été dissous et les nouvelles élections, convoquées pour le 26 octobre, remportées par le Parti populaire avec 48,45% des suffrages (57 sièges), contre 38,97% au Parti socialiste (45 sièges) et 8,49% à Izquierda unida (9 sièges). En mai, le Parti socialiste avait justifié la défection de ses élus par un complot qui aurait été ourdi par des entrepreneurs immobiliers, proches du Parti populaire et opposés à l'arrivée des forces de gauche au pouvoir. Les travaux de la commission d'enquête parlementaire chargée cet été d'étudier le dossier n'ont pas permis de mettre en évidence l'existence d'une telle affaire de corruption. Le scandale politique a finalement été fatal aux forces de gauche sanctionnées par les 4,4 millions d'électeurs de la région de Madrid.
Plus récemment, c'est de Catalogne que sont venus les problèmes. Le 26 janvier dernier, le conseiller en chef de la Généralité (gouvernement) de Catalogne, Josep Lluis Carod Rovira, président de l'Esquerra republicana de Catalunya (ERC), formation de gauche, a reconnu avoir rencontré secrètement des dirigeants de l'organisation terroriste basque ETA. José Luis Rodriguez Zapatero, tout en condamnant cette rencontre, a estimé qu'il appartenait à Pasqual Maragall (PSC), président socialiste du gouvernement catalan de régler ce problème avant de demander la démission de Josep Lluis Carod Rovira. Le chef de l'exécutif catalan a accepté le départ du numéro deux de la Généralité de son poste mais l'a gardé au sein de son gouvernement, en tant que ministre sans portefeuille. Josep Lluis Carod Rovira devrait mener la liste de sa formation aux élections législatives du 14 mars prochain. Les socialistes ont montré à cette occasion leur embarras et leurs difficultés de positionnement sur un sujet qui fait pourtant l'objet d'un consensus au sein de la population. En effet, la lutte contre le terrorisme est en Espagne une politique assumée tant par le pouvoir que par l'opposition
Les socialistes se montrent confiants dans la reconquête du pouvoir. « Nous pouvons obtenir la majorité suffisante » a affirmé leur secrétaire général. José Luis Rodriguez Zapatero a également annoncé que la première loi que sa formation voterait une fois au pouvoir concernerait la violence domestique dont souffrent de nombreuses femmes (selon les statistiques, 30 000 cas de violences domestiques ont été enregistrés en 2003 et soixante-dix femmes ont été tuées durant cette même année au cours de disputes avec leur conjoint). Le leader socialiste a également promis de sortir l'Espagne de « l'isolement » où l'a placée selon lui José Maria Aznar en soutenant l'intervention américaine en Irak. « Je veux être le président d'un gouvernement qui sorte l'Espagne du trio des Açores (allusion à la rencontre entre José Maria Aznar, George Bush et Tony Blair le 16 mars 2003). Je veux voir mon pays aux côtés de Lula, de Kofi Annan, de Lagos et de Jacques Chirac » a t-il déclaré, accusant le gouvernement Aznar d'avoir « fracturé l'Europe ». Le chef de l'opposition, qui a assuré les militaires de son soutien total, a annoncé qu'il ordonnerait le retrait des troupes déployées en Irak si les Nations unies ne reprennent pas la situation en main. Un contingent, de mille trois cents soldats, est actuellement stationné en Irak.
José Luis Rodriguez Zapatero a présenté début janvier son équipe de campagne, constituée de dix personnalités politiques parmi lesquelles Pedro Solbes, actuel commissaire européen chargé des affaires économiques et Miguel Angel Moratinos, ancien envoyé européen au Moyen Orient.
Les enjeux de l'élection
Le Parti socialiste a choisi de faire de la réforme de l'Etat l'un de ses thèmes de campagne électorale, proposant d'accroître les compétences des dix-sept communautés autonomes que compte le pays et de transformer le Sénat en Chambre de représentation territoriale. La réforme du PSOE vise à améliorer la représentation et la participation des régions espagnoles et prévoit une participation directe et permanente des communautés autonomes dans les organismes internationaux, notamment européens, et l'institution d'une conférence annuelle entre les présidents régionaux et le chef du gouvernement central. Les mesures socialistes, proposées au moment où le gouvernement basque a lancé une véritable fronde contre l'Etat, ont suscité une polémique que le Parti populaire s'est empressé d'aviver. En effet, le 25 octobre dernier, le chef de l'exécutif basque Juan José Ibarrexte a officialisé son plan, appelé plan Ibarrexte, revendiquant pour le Pays basque un statut de « libre association avec l'Espagne », les pleines prérogatives dans certains domaines (justice, immigration, etc.) et surtout le droit à l'autodétermination et donc une modification du statut d'autonomie du 25 octobre 1979. « Nous, les Basques, avons des droits historiques anciens et nous voulons aujourd'hui exercer cette souveraineté » a-t-il déclaré. Ce projet, qui - pour être adopté - requiert l'approbation des deux tiers du Parlement espagnol, une révision constitutionnelle et la ratification par référendum, a été rejeté par les deux grandes formations politiques du pays. Au même moment, le soutien de José Luis Rodriguez Zapatero à Pasqual Maragall, secrétaire général du Parti socialiste catalan, et à sa volonté de réviser le statut de la Catalogne, a créé un certain trouble au sein du Parti socialiste que la récente rencontre du numéro deux de l'exécutif catalan, Josep Lluis Carod Rovira, avec des dirigeants de l'organisation terroriste basque ETA n'a pas contribué à apaiser.
Au sein du PSOE sont apparues des divergences sur la conception de l'unité de l'Etat, divergences que José Luis Rodriguez Zapatero semble avoir des difficultés à aplanir. Mi janvier, Juan Carlos Rodriguez Ibarra, président socialiste de l'Estrémadure, a ainsi proposé d'exclure du Congrès des députés les formations obtenant moins de 5% des suffrages. Cette proposition, qui aurait pour conséquence d'exclure de la Chambre l'ensemble des partis nationalistes, a été immédiatement rejetée par la grande majorité des socialistes mais a encore accru l'impression de confusion régnant au sein de la principale formation d'opposition et les doutes quant aux capacités du PSOE à tenir tête aux indépendantistes basques ou catalans.
Le Parti populaire, qui a eu beau jeu de centrer la campagne électorale sur l'unité du pays et sur le modèle territorial espagnol, a affirmé sa volonté de maintenir les autonomies régionales telles qu'elles ont été définies par la Constitution de 1978 et mis en garde la population contre « l'aventure » que représenterait un approfondissement de ces autonomies. « Le PSOE n'est plus un parti national. Il a dix-sept programmes, un pour chaque région autonome » répètent les candidats du Parti populaire. A l'occasion du vingt-cinquième anniversaire de la Constitution, la Carta Magna, le 6 décembre dernier, José Maria Aznar s'est posé en fervent défenseur du texte de 1978 et a mis en garde contre le danger que font peser sur l'avenir de l'Espagne ceux qu'il qualifie de « révisionnistes », c'est-à-dire les nationalistes basques ou catalans.
José Maria Aznar a dressé son propre éloge il y a quelques semaines. « Depuis 1996, 4,3 millions de personnes de plus travaillent en Espagne, le chômage est passé de 23% à 11%, l'économie a crû de 64% et le revenu par habitant de 36%. L'Espagne a besoin de la garantie du Parti populaire pour continuer sur la voie du progrès et de la stabilité institutionnelle. Nous avons été élus pour respecter nos engagements, pour ne pas décevoir et je vous demande de ne pas l'oublier le 14 mars où le bien être et la prospérité de tous sont en jeu » a t-il déclaré. Si ce bilan doit certainement être nuancé, la bonne santé économique de la péninsule ibérique est réelle. Ainsi, depuis 1997, la croissance moyenne a atteint 4% du PIB (2,4% l'année passée, pour 0,5% dans la zone euro). Cependant, beaucoup reste à faire en matière sociale, le chômage restant le plus élevé de l'Union européenne et le nombre d'emplois précaires important (30%). Une récente étude de l'Université Pompeu Fabra de Barcelone relève qu'entre 1993 et 2001, le poids des dépenses sociales par rapport au PIB est passé de 24% à 20,1% et que le différentiel du pays avec la moyenne européenne s'est accru de 4,8 à 7,2 points. La crise économique, la création d'emplois et la sécurité sont les problèmes majeurs des Espagnols. Sur ces sujets, les socialistes peinent à se poser en véritable alternative.
Selon l'ensemble des enquêtes d'opinion, le Parti populaire devance largement le Parti socialiste. Le dernier sondage, réalisé par Sigma Dos et publié par El Mundo le 8 février, indique que le Parti populaire recueille 44,3% des intentions de vote, contre 34,8% au Parti socialiste. Le quotidien commente ainsi cette enquête : « Le Parti populaire est sûr de gagner mais José Luis Rodriguez Zapatero peut encore éviter qu'il obtienne la majorité absolue ». Précisons également que le nombre d'indécis demeure important. Les sondages prévoient une progression des petites formations. Izquierda unida (IU) pourrait ainsi obtenir de 8 à 11 sièges, l'Esquerra republicana de Catalunya (ERC) passer de 1 à 4 sièges et la Coalition des Canaries (CC), alliée au Parti populaire au Parlement, cinq députés. Enfin, le candidat du Parti populaire à la présidence du gouvernement, Mariano Rajoy, est mieux noté, en termes d'image, que son adversaire socialiste, José Luis Rodriguez Zapatero (5,25 points, contre 4,59). La campagne électorale commencera officiellement le 27 février et s'achèvera le 12 mars. Parallèlement au scrutin législatif se dérouleront également des élections régionales en Andalousie.
Rappel des résultats des élections législatives du mars 2000
Participation : 69,98%
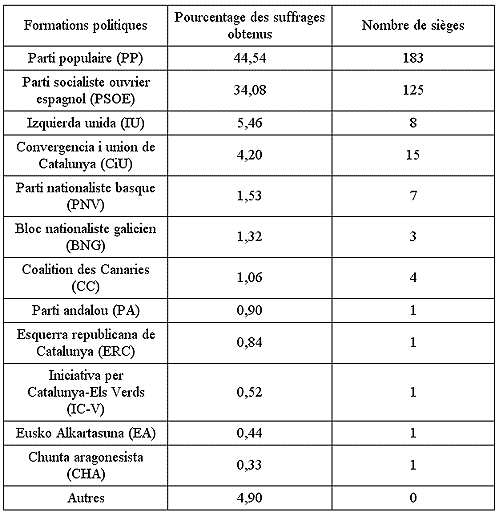 Source Congrès des députés espagnol
Source Congrès des députés espagnolSur le même thème
Pour aller plus loin
Élections en Europe
Corinne Deloy
—
28 avril 2025
Élections en Europe
Corinne Deloy
—
28 avril 2025
Élections en Europe
Corinne Deloy
—
14 avril 2025
Élections en Europe
Corinne Deloy
—
24 février 2025

La Lettre
Schuman
L'actualité européenne de la semaine
Unique en son genre, avec ses 200 000 abonnées et ses éditions en 6 langues (français, anglais, allemand, espagnol, polonais et ukrainien), elle apporte jusqu'à vous, depuis 15 ans, un condensé de l'actualité européenne, plus nécessaire aujourd'hui que jamais
Versions :




