Actualité
Corinne Deloy,
Fondation Robert Schuman
-

Versions disponibles :
FR
EN
Corinne Deloy
Fondation Robert Schuman
42,5 millions de Turcs sont appelés aux urnes le 22 juillet prochain pour renouveler les 550 membres de la Grande Assemblée nationale, Chambre unique du Parlement. 7 395 candidats, dont 726 indépendants, représentant au total 17 partis politiques sont en lice pour ces élections anticipées de 4 mois après que le Parlement a échoué, en mai dernier, à élire le successeur de Ahmet Necdet Sezer à la Présidence de la République.
Retour sur la crise d'avril-mai dernier
La perspective de voir un membre du Parti de la justice et du développement (AKP), considéré par beaucoup comme un "islamiste", élu à la Présidence de la République a provoqué une importante crise politique en Turquie en avril dernier. A l'issue du 1er tour de scrutin, le 27 avril, le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Abdullah Gül (AKP), seul candidat en lice, avait recueilli 357 suffrages sur les 361 députés présents (le Président de la République est élu en Turquie au vote secret à la majorité des deux tiers des suffrages de la Grande Assemblée nationale, soit 367 voix sur 550). Le Parti républicain du peuple (CHP), principale formation d'opposition dirigée par Deniz Baykal, avait boycotté l'élection, ainsi que la majorité des députés présents du Parti de la mère patrie (ANATAVAN) et du Parti de la juste voie (DYP).
Comme il l'avait annoncé avant le scrutin, le Parti républicain du peuple avait déposé un recours en justice pour faire annuler le vote au motif que les deux tiers des membres de la Grande Assemblée nationale, soit 367, n'étaient pas physiquement présents lors du vote alors que, selon le parti, la Constitution requiert la présence d'au moins les deux tiers des députés pour valider l'élection du Président de la République.
Dans la soirée du 1er tour, le général Yasar Büyükanit, chef d'état-major des armées, avait fait un communiqué "En cas de nécessité, les forces armées exprimeront clairement et nettement leur position et agiront en conséquence. Nul ne doit en douter. Tous ceux qui s'opposent à la conception du fondateur de notre République, Mustafa Kemal Atatürk, sont les ennemis de la République et le resteront". Ce texte a été qualifié de "coup d'Etat électronique" de la part des autorités militaires. Le 1er mai, la Cour constitutionnelle, dont sept des onze membres ont été nommés par l'actuel Président de la République Ahmet Necdet Sezer, annulait, par 9 voix contre 2, le premier tour de l'élection présidentielle du 27 avril, donnant raison au Parti républicain du peuple au grand étonnement de nombreux juristes qui contestaient que la Constitution exige un quorum pour la tenue de l'élection présidentielle.
"La décision de la Cour constitutionnelle a bloqué le système parlementaire démocratique. Pour le débloquer et mettre fin à la domination de la minorité sur la majorité, la solution est de nous tourner vers la nation, le peuple prendra les meilleurs décisions" avait alors déclaré le Premier ministre, Recep Tayyip Erdogan qui a annoncé des élections législatives anticipées dont la date a été fixée au 22 juillet prochain.
Le 6 mai, un nouveau 1er tour de l'élection présidentielle était organisé à la Grande Assemblée nationale : Abdullah Gül, toujours seul candidat en lice, échouait de nouveau à obtenir le nombre de suffrages nécessaire pour accéder à la magistrature suprême.
Les formations politiques de l'opposition et une partie des élites turques, pas forcément démocrates et souvent issues des milieux nationalistes et antioccidentaux, ont mobilisé avec succès le peuple sur la menace qui, selon elles, pesait sur la laïcité. Durant plusieurs semaines, les manifestations, d'abord contre une éventuelle candidature à la Présidence de la République du Premier ministre Recep Tayyip Erdogan puis contre celle d'Abdullah Gül et en faveur de la défense d'une Turquie laïque, se sont succédées dans le pays.
Le 10 mai dernier, le gouvernement a fait adopter par le Parlement (376 voix pour et 55 contre) une réforme constitutionnelle qui modifie les institutions et permet l'organisation des élections législatives tous les 4 ans (le mandat des parlementaires est actuellement de 5 ans) ainsi que l'élection du Président de la République au suffrage universel pour un mandat de 5 ans renouvelable une fois (au lieu d'un mandat unique de 7 ans). La loi abaisse également l'âge d'éligibilité des députés à 25 ans (contre 30 actuellement) et fixe à 184 voix le quorum nécessaire pour le vote des textes de loi.
Le 25 mai, le Président de la République Ahmet Necdet Sezer apposait son veto sur cette réforme constitutionnelle estimant que "le changement de régime visé par cette réforme n'est pas nécessaire et n'a pas de justification ni de raison acceptable" mais cinq jours plus tard, le Parlement a réapprouvé le texte par 370 voix pour et 21 contre. Le Chef de l'Etat, qui a par ailleurs, comme les formations de l'opposition, déposé un recours en annulation devant la Cour constitutionnelle d'une série d'amendements de la réforme, n'avait alors plus d'autre choix que de promulguer le texte ou de le soumettre à référendum.
Le 2 juin, la Grande Assemblée nationale a voté un texte pour réduire la durée nécessaire à l'organisation d'un référendum de 120 jours à 45 afin que les élections législatives et le référendum sur le mode de désignation du Chef de l'Etat puissent se dérouler le même jour. Le Président de la République, Ahmet Necdet Sezer, a rejeté cette mesure le 18 juin, estimant que "la tenue simultanée d'élections législatives et d'un référendum créerait de la confusion et rendrait difficile un résultat appréciable sur cette question".
Toutes les enquêtes d'opinion montrent que la majorité des Turcs sont favorables à l'élection du Président de la République au suffrage universel. La question a fait l'objet de nombreux débats depuis plusieurs années et a été rejetée en 1989, sous la présidence de Turgut Ozal (1989-1993), la majorité des hommes politiques considérant que le pays n'était pas prêt à s'engager dans la voie d'un système présidentiel. La concentration des pouvoirs dans les mains d'un seul homme continue à effrayer de nombreux Turcs qui craignent que cela soit fatal à la démocratie turque et ouvre la voie à un régime autoritaire. Beaucoup demandent que le pays renforce au préalable son système judiciaire de façon à ce que celui-ci devienne un véritable contrepouvoir avant d'envisager une élection du Président de la République par le peuple.
Le système politique turc
Chambre unique du Parlement, la Grande Assemblée nationale comprend 550 membres élus tous les 5 ans au scrutin proportionnel avec répartition des restes à la plus forte moyenne. L'âge requis pour être député est de 30 ans, le candidat devant par ailleurs posséder au minimum un niveau d'instruction d'enseignement primaire. En 1995, des amendements constitutionnels ont porté le nombre de députés à 550 et abaissé la majorité électorale à 18 ans. Pour être représentée au Parlement, toute formation politique doit présenter des candidats dans au moins la moitié des provinces du pays et recueillir au moins 10% des suffrages exprimés au niveau national. Ce seuil de 10% est particulièrement élevé et très préjudiciable aux 15 millions de citoyens kurdes que compte la Turquie. En effet, la principale formation kurde, le Parti de la société démocratique (DTP), ne peut envisager recueillir 10% des voix au niveau de l'ensemble de la Turquie.
"La Constitution parle de juste représentation mais le Parlement ne représente que la moitié des électeurs" souligne Orhan Miroglu, membre du Parti de la société démocratique. En effet, 6,2% des électeurs ont voté lors des dernières élections législatives du 3 novembre 2002 en faveur du Parti de la société démocratique et jusqu'à 70% dans les régions kurdes mais la formation n'a obtenu aucun siège de député au Parlement. Environ 45% des électeurs ne sont d'ailleurs pas représentés à la Grande Assemblée nationale. Pour contourner cet obstacle, un grand nombre de membres du Parti de la société démocratique ont donc choisi de se présenter comme candidats indépendants aux élections législatives du 22 juillet prochain. Ils espèrent ainsi remporter une vingtaine de sièges au Parlement.
Le 30 janvier dernier, la Cour européenne des droits de l'Homme qui avaient été interpellée sur la question des 10% par deux citoyens turcs, Mehmet Yumak et Resul Sadak, a affirmé que ce seuil électoral, le plus élevé des 46 membres du Conseil de l'Europe, ne constituait pas une atteinte à la liberté du vote. L'institution européenne a cependant préconisé que ce seuil soit abaissé et conseillé l'ouverture de discussions entre les formations politiques sur ce sujet. Les autorités turques ont, cette année, modifié la procédure de vote. Alors qu'auparavant, les candidats indépendants disposaient chacun de bulletins de vote différents, ils seront désormais tous inscrits sur la même feuille, ce qui pourrait entraîner de la confusion dans un pays où une grande partie des électeurs sont toujours analphabètes, notamment dans les régions kurdes.
La Constitution stipule que le Premier ministre soit un élu du Parlement et la loi électorale oblige à modifier le gouvernement pendant la campagne électorale des élections législatives. Ainsi, les ministres de l'Intérieur, de la Justice et des Transports doivent être remplacés par des personnalités indépendantes et les autres membres de l'équipe gouvernementale doivent être choisis parmi les groupes parlementaires selon l'importance de ceux-ci.
Actuellement, deux formations politiques seulement sont représentées au Parlement :
- le Parti de la justice et du développement (AKP), formation du Premier ministre Recep Tayyip Erdogan créée en 2001 sur les cendres d'une formation islamiste interdite (Parti de la prospérité, Refah), possède 363 sièges ;
- le Parti républicain du peuple (CHP), principal parti d'opposition situé au centre gauche sur l'échiquier politique et dirigé par Deniz Baykal, compte 178 députés.
Les autres formations politiques sont les suivantes :
- le Parti de l'action nationale (MHP), parti ultranationaliste dirigé par Devlet Bahceli ;
- le Parti de la juste voie (DP, anciennement DYP), formation de centre droit dont le leader est Mehmet Agar ;
- le Parti de la mère patrie (ANTAVAN, anciennement ANAP), parti de centre droit dirigé par Erkan Memcu ;
- le Parti des jeunes Turcs (GP, anciennement Genc), formation située sur la droite de l'échiquier politique et créée par Cem Uzan, propriétaire de la chaîne de télévision Star et du journal du même nom, souvent qualifié de Silvio Berlusconi turc ;
- le Parti de la gauche démocratique (DSP), parti social-démocrate dirigé par Zeki Sezer ;
- le Parti de la société démocratique (DTP), principale formation kurde de Turquie fondée en 2005 à partir de la fusion du Parti démocratique du peuple (DEHAP) et du Mouvement de la société démocratique (DTH). Ses deux leaders, Ahmet Turk et Aysel Tugluk, ont été arrêtés et emprisonnés en février dernier pour avoir distribué des tracts en langue kurde, ce qui est formellement interdit par la loi. Ahmet Turk a été condamné à une peine de six mois d'emprisonnement cette année pour avoir "glorifié" Abdullah Ocalan, le leader du Parti des travailleurs kurdes (PKK), qui purge actuellement une peine de prison à vie pour activité terroriste. Les deux leaders kurdes ont fait appel et ont été libérés dans l'attente du jugement.
Le Parti de la mère patrie et le Parti de la juste voie avaient décidé de fusionner, mais la tentative a échoué faute d'accord sur la répartition des candidats sur les listes électorales. Le Parti républicain du peuple s'est uni au Parti de la gauche démocratique. "Notre peuple nous a demandé de nous unir et nous l'avons fait. Maintenant, nous attendons que l'unité se manifeste encore davantage dans les urnes" a déclaré le leader de la principale formation d'opposition, Deniz Baykal. Ce dernier est candidat dans la ville d'Antalya où il sera opposé à Mehmet Ali Sahin (AKP). Par ailleurs, Orsan Kunter Oymen, en qui tout le monde voyait le successeur de Deniz Baykal à la tête du parti, a choisi de ne pas participer aux élections après avoir constaté qu'il figurait en 14e position sur la liste de son parti à Istanbul.
La Grande Assemblée nationale compte 24 femmes, soit 4,4% du total, ce qui met la Turquie à la 123e place du classement mondial (189 pays) réalisé par l'Union interparlementaire. Le Parti de la justice et du développement et le Parti républicain du peuple ont quasiment doublé leur nombre de candidates pour les élections législatives du 22 juillet par rapport au scrutin du 3 novembre 2002. L'AKP présente 62 candidates, dont 24 figurent en tête de liste. Aucune d'entre elles ne porte le voile. Le CHP présente 52 candidates, dont 12 ont une chance d'être élues ; le Parti de la juste voie, 58 candidates (dont trois pourraient accéder au Parlement) et le Parti jeunes turcs, 128 femmes, dont 8 figurent en têtes de liste.
Le bilan de quatre années de gouvernement du Parti de la justice et du développement
En 2001, le PIB enregistrait un recul de 8,5%, l'inflation s'élevait à 68,5% et la dette publique et privée du pays atteignait près de 210 millions d'euros soit 104% du PIB. Kemal Dervis, ancien vice-président de la Banque mondiale devenu ministre de l'Economie et du Trésor, avait alors engagé le pays dans la restructuration complète de son économie avant de démissionner de son poste le 10 août 2002, soit trois mois avant les élections législatives qui ont vu l'arrivée au pouvoir du Parti de la justice et du développement. Après quatre années à la tête de la Turquie, le gouvernement du Premier ministre Recep Tayyip Erdogan, qui se définit comme un démocrate conservateur, peut afficher un bon bilan économique. Entre 2002 et 2007, la croissance du PIB s'est élevée à 6,1% en 2006, le revenu par habitant a augmenté, passant de 2 598 dollars en 2002 à 5 477 dollars en 2006, la dette a fondu, les exportations se sont accrues (94 milliards de dollars en 2006), l'inflation s'établit à 9,6%. Enfin, les investissements étrangers se sont élevés à 9,6 milliards de dollars en 2005 et à 19,8 milliards l'an passé. Le chômage reste encore élevé (10,4% de la population active) et un quart de la population vit encore sous le seuil de pauvreté. Le 11 juin dernier, le ministre des Finances, Kemal Unakitan, a affirmé que le Parti de la justice et du développement baisserait les charges sociales après les élections du 22 juillet. En mai, le gouvernement avait également annoncé une baisse de dix points de la TVA sur les produits touristiques.
Le 12 juin dernier, le Fonds monétaire international (FMI) a déclaré : "Les performances macroéconomiques de la Turquie de ces dernières années doivent beaucoup aux politiques macroéconomiques disciplinées des autorités, au renforcement des institutions et aux réformes structurelles, dans un contexte extérieur favorable, une situation politique stable et un engagement ferme vis-à-vis des accords conclus avec le Fonds monétaire international". "La Turquie est à un moment crucial. Nous continuerons sur le chemin que nous avons initié, vers plus de démocratie, plus de justice, une plus juste redistribution et une plus grande liberté" a déclaré le Premier ministre Recep Tayyip Erdogan le 13 juin dernier.
"Quand ils sont arrivés au pouvoir il y a cinq ans, les membres du Parti de la justice et du développement ont dû prouver qu'ils étaient démocrates et qu'ils respecteraient la Constitution séculière turque. Mais le Parti de la justice et du développement est toujours en probation. Chaque jour qui passe, la formation doit de nouveau prouver qu'elle n'est pas islamiste" souligne Emel Kurma, directrice de l'Assemblée des citoyens d'Helsinki. Le Premier ministre Recep Tayyip Erdogan a parfois effrayé une partie des Turcs en exprimant, par exemple, son désir de lever l'interdiction de porter le foulard dans les écoles et les bâtiments publics ou de soutenir financièrement les écoles religieuses Durant la législature, il a également tenté de criminaliser l'adultère (avant d'être rappelé à l'ordre par l'Union européenne) et plusieurs municipalités gérées par son Parti ont voté les mesures pour réduire la consommation d'alcool ou renommé certaines rues d'après des figures de la culture musulmane. Cependant, le gouvernement a modifié en profondeur les Codes civil et pénal en faveur des droits des femmes et accru les peines pour les hommes accusés de viol sur leurs épouses et pour ceux impliqués dans les crimes d'honneur qui ne sont en fait que des assassinats de femmes. "Le Parti de la justice et du développement est le véritable héritier de Mustafa Kemal Atatürk" souligne le ministre des Affaires étrangères, Abdullah Gül, "Quand il a fondé la République moderne en 1923, Mustafa Kemal Atatürk a choisi le sécularisme parce qu'il considérait que la religion était un obstacle au progrès. Son but était de moderniser la Turquie et de l'unir à l'Europe, c'est ce que nous faisons et ce faisant, nous sommes fidèles à l'objectif de Mustafa Kemal Atatürk".
"Le Parti de la justice et du développement se situe au centre de l'échiquier politique et rejette tout extrémisme. Nous rejetons le nationalisme régional religieux ou ethnique et nous répondons aux demandes de changements venues de la droite comme de la gauche de l'échiquier politique" affirme le Premier ministre. S'exprimant le 16 juin à Siirt, ville du Sud-Est de la Turquie dont il est l'élu, Recep Tayyip Erdogan a accusé le Parti républicain du peuple d'avoir violé la démocratie en commettant l'une des plus grandes erreurs de l'histoire durant l'élection présidentielle. "La seule chose que sait faire l'opposition, qui a peur des électeurs et qui en appelle sans cesse à la Cour constitutionnelle, c'est de générer des crises".
La campagne électorale
Après les multiples interrogations sur la place de la religion dans la société, un nouveau thème figure désormais au cœur du débat public : le nationalisme. Les "islamistes" sont-ils des Turcs loyaux ? Telle est la question qui a envahi la scène politique. En effet, l'accroissement des opérations du Parti des travailleurs kurdes (PKK) fait varier le discours de certains partis de l'opposition qui accuse le gouvernement de refuser une intervention militaire de l'armée turque dans le nord de l'Irak (selon les analystes, la région est utilisée comme base arrière par les combattants kurdes) et d'être sous la coupe des Etats-Unis et de l'Union européenne. En 2005, le Premier ministre avait tenté de trouver une solution en impliquant la population kurde vivant en Irak, une initiative que les forces armées turques avaient très peu appréciée. Recep Tayyip Erdogan, qui a été le premier leader turc à reconnaître que l'Etat avait fait des "erreurs" lors de ses précédentes négociations avec les Kurdes, avait alors dû reculer.
En dépit d'un cessez-le-feu décrété en octobre dernier, le Parti des travailleurs kurdes, qui se bat depuis 1984 pour la création d'un Etat kurde à cheval sur le nord de l'Irak et le sud de la Turquie, a intensifié ses opérations en Turquie faisant plusieurs dizaines de morts et de blessés dont de nombreux soldats turcs. Recep Tayyip Erdogan est hostile à une intervention de l'armée turque au delà de la frontière contre les bases du Parti des travailleurs kurdes en Irak (tout au moins avant les élections législatives du 22 juillet prochain) estimant que celle-ci serait préjudiciable à l'économie turque et qu'elle entraînerait le retrait immédiat du pays des investisseurs étrangers. "Une décision du Parlement est nécessaire au déclenchement d'une opération transfrontalière" a précisé le Premier ministre le 6 juin. Pour l'heure, la population semble partager les positions de Recep Tayyip Erdogan puisque, selon une enquête d'opinion publiée par le journal Tempo, une minorité de Turcs se disent favorables à une intervention militaire (39% contre 43% qui y sont opposés). Les puissances occidentales, Union européenne et Etats-Unis, y sont également hostiles considérant qu'une intervention de l'armée turque provoquerait un désastre dans le pays et dans les Etats arabes qui l'entourent.
Le Parti républicain du peuple mène campagne sur l'inaction du gouvernement face à la violence du Parti des travailleurs kurdes. "La Turquie a besoin d'une autorité politique qui ferait du terrorisme sa priorité et saurait comment le combattre" a déclaré son leader, Deniz Baykal. Le Parti républicain du peuple se pose également en ardent défenseur des valeurs républicaines qui seraient menacées par le Parti de la justice et du développement. La formation, qui a boycotté l'élection présidentielle en avril et conduit à l'annulation du scrutin, a été le fer de lance des manifestations qui se sont déroulées durant plusieurs semaines.
La question fondamentale qui se pose à la Turquie semble être, au-delà de la place de la religion ou du nationalisme, celle de sa modernisation ou plutôt de la modernisation du kémalisme. Le Parti de la justice et du développement abrite différentes tendances dont certaines souhaitent voir l'islam jouer un plus grand rôle dans la société. Le Premier ministre a la difficile tâche d'apaiser le camp des laïcs en satisfaisant les plus religieux de ses partisans, mission qu'il n'est pas toujours parvenu à mener à bien. "Présenter la Turquie comme si elle était divisée en deux camps est criminel. Même si nos opinions et nos modes de vie divergent, nous sommes un seul pays, une seule Turquie" affirme t-il. Le nombre de Turcs souhaitant voir s'établir un Etat islamique a chuté de 20% en 99 à 9% et le pourcentage de femmes qui couvrent leurs cheveux lorsqu'elles sont hors de leur domicile a reculé dans le même temps de 74% à 64%. Mais les femmes du Premier ministre et du ministre des Affaires étrangères ne l'ont pas fait. De même, moins d'un quart des Turcs estiment que la laïcité est menacée, 12% parmi les moins favorisés, mais 40% parmi les plus riches et les plus diplômés. Le véritable enjeu de la crise actuelle concerne certainement moins la religion que le partage du pouvoir politique et économique entre les vieilles élites kémalistes et les nouvelles élites issues du Parti de la justice et du développement. "La querelle n'a rien à voir avec la religion. C'est la lutte des petits bourgeois. C'est le résultat de la montée en puissance de ce qu'on appelait les "capitaux anatoliens" ou "capitaux verts" qui se dressent à présent comme une nouvelle élite face aux anciennes élites qui gouvernent le pays depuis les années trente" analyse Baskin Oran, politologue et professeur de relations internationales à Ankara. "Ces élections législatives sont un moment déterminant dans l'histoire turque. Elles sont un référendum sur la voie que veut emprunter le peuple turc" souligne Fadi Hakura, analyste turque à Chatham House.
Selon la dernière enquête d'opinion réalisée par l'institut Konda et publiée le 18 juin dernier, le Parti de la justice et du développement recueillerait 41,9% des suffrages lors des élections législatives du 22 juillet et remporterait 307 sièges, soit la majorité absolue. Le Parti républicain du peuple est crédité de 22% des voix et le Parti de l'action nationale de 11%. 40 candidats indépendants pourraient également entrer à la Grande Assemblée nationale.
Résultats des élections législatives du 3 novembre 2002 en Turquie
Participation : 79% (le vote est obligatoire en Turquie)
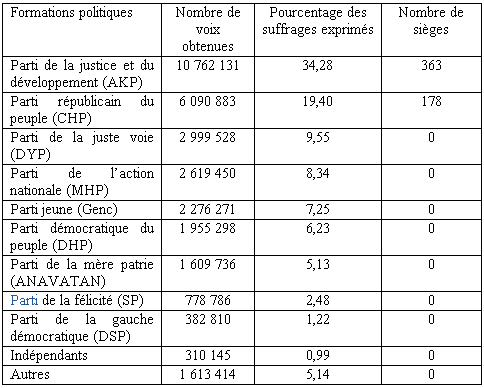 Source : Agence France Presse
Source : Agence France PresseSur le même thème
Pour aller plus loin
Élections en Europe
Corinne Deloy
—
14 avril 2025
Élections en Europe
Corinne Deloy
—
24 février 2025
Élections en Europe
Corinne Deloy
—
17 février 2025
Élections en Europe
Corinne Deloy
—
27 janvier 2025

La Lettre
Schuman
L'actualité européenne de la semaine
Unique en son genre, avec ses 200 000 abonnées et ses éditions en 6 langues (français, anglais, allemand, espagnol, polonais et ukrainien), elle apporte jusqu'à vous, depuis 15 ans, un condensé de l'actualité européenne, plus nécessaire aujourd'hui que jamais
Versions :



